Robert AUFAN,(robert.aufan@orange.fr) est seul titulaire de l'intégralité des droits
d'utilisation et d'exploitation des textes et des documents personnels (schémas, cartes,
photographies…) utilisés sur ce site. Ces fonds sont exclusivement réservés à
un usage non commercial. Toute utilisation à des fins d'édition est donc
rigoureusement interdite. En tout état de cause, toute diffusion des documents
devra comporter l’indication d’origine.
Chapitre III:
Le gemmage et l’utilisation des
produits résineux dans la Montagne
de La Teste
I- Les témoignages anciens (XVII° et XVIII° siècles)
Pour connaître la façon dont étaient gemmés
les pins avant que les usines de distillation ne s’installent, il faut
mobiliser les témoignages anciens. Mais
avant le XVIII° siècle, les témoignages sont succincts d’autant que rares sont
les mentions d’outils dans les actes notariés de succession.
J’ai
pu cependant relever le testament de Jean Daicard,
laboureur, habitant de la paroisse de Gujan, quartier de
Quelques années plus tard le 30 Novembre 1727[2]
sont inventoriés dans un acte: « deux haches à gemmer, une petite pelle
à gemmer et un barresquit »
Nous pouvons donc affirmer que les outils appelés hapchot,
sarcle de pela, barrasquit et palot ou pelle existent depuis cette époque.
Déjà, en 1672, J.Lombard[3]
décrivait ainsi les opérations :
« A l'âge de 25 ans il (le pin)
commence à fluer les gommes, qu'il continue à donner pendant l'ordre des
saisons, et l espace d'un temps considérable, même durant plus de cent années,
qu'il donne du profit à son maître: Il est vrai que l'ouvrier doit lui rendre
ses assiduités pour le travailler, afin que par l'ouverture qu'il faut
fréquemment renouveler avec la cognée… »
Nous avons aussi deux textes du début du XVIII° siècle qui, s’ils ne précisent pas expressément qu’il s’agit de la Montagne, décrivent plus précisément les techniques qui y étaient alors utilisées.
Le premier est du géographe Masse [4],
en 1708, dans son article intitulé
"Bois de pinada"
« Quand ces arbres ont 18 à 20 ans,
d'une grosseur et hauteur convenable, les résiniers donnent un coup de hache
ou de serpette pour enlever l'écorce et un peu du vif de l'arbre, d'où il sort
quand il fait chaud une gomme blanche qui distille insensiblement dans une
petite fosse ou bacquet, que les résiniers amassent et qu’ ils portent dans
leurs cabanes qui sont établies de coté et d'autre dans ces bois…
Ils tailladent ces arbres dans tout le
pourtour en différentes années jusqu'à ce qu'ils aient tiré la substance »
Le second date de 1709[5].
Il s’agit des « Eclaircissements
apportés à Mr De Fenelon député à
« On commence ordinairement à travailler
au mois de Mars et on continue jusques à celluy d'Octobre ou de Novembre;
l'ouvrier coupe le pin d'un côté, à la hauteur de 2 ou
Ces deux textes datent de l’époque, on le verra, où l’on
n’utilisait pas de pots pour recueillir la gemme.
II- Les opérations et les outils de gemmage
Selon les auteurs les outils utilisés pour telle ou telle opération changent de nom.
En fait deux éléments
sont à considérer : d’abord la plupart des grands traités concernent les
Landes et d’autre part chaque résinier façonnait ses outils afin qu’ils soient
le mieux possible adaptés à sa main et précisait au taillandier, l’artisan qui
fabrique des outils tranchants, la façon dont il voulait que les lames soient
façonnées. Le choix de l’artisan était important, à preuve ce témoignage du
fils d’Alexis Baillon, résinier testerin de la fin du XIX° siècle :
« Quand les outils avaient besoin
d’être réparés ou changés, mon père allait chez le taillandier. Il utilisa
d’abord les services de celui de Sanguinet puis leur préféra ceux du
taillandier de Biscarrosse. Il se rendait chez eux à pied en suivant les bords
du lac et rentrait que très tard, le soir, après une marche de 45 à
1- Les outils en 1864 (Eloi Samanos)[7] et 2- en 1974 (Col. R.Aufan)
-------- 
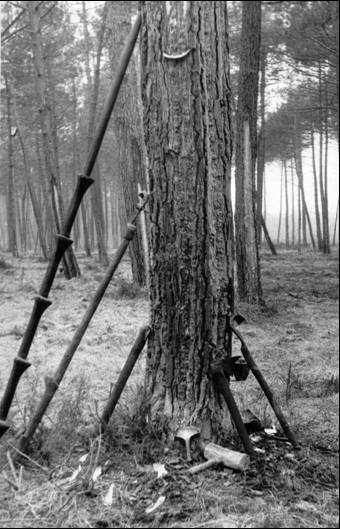 ---------------
---------------
C’est
pourquoi les notes ci-dessous ne concernent que la forêt usagère de La Teste,
même si, en complément, j’évoque parfois les techniques landaises.
A- L’écorçage :
Nous
avons vu que dès le début du XVIII° siècle, le « sarcle de pela » est
utilisé en Buch, ailleurs c’est l’espourguit
(Mimizan).
-----------------
 ---------------
---------------
3- Ecorçage au sarcle
(Ph.R.Aufan) et 4- Lame du sarcle de pela (Col.
R.Aufan)
Ces
deux outils agissent du haut vers le bas. Il s’agit, avec ce sarcle d’enlever l’écorce afin de pouvoir
préparer l’entaille ou « care » que sa lame courbe permet de tailler en creux pour
faciliter l’écoulement de la gemme. On dit aussi « peler » le pin
puisqu’on commence par enlever l’écorce.
B- La care :
Elle
est pratiquée avec une cognée (terme qu’emploie
le « français » Lombard en 1672) qu’on appelle ici
« hapchot » dès 1702 et certainement
avant. Thore, médecin chef de l’hôpital de Dax, le décrit, en
1810, comme une « hache
au tranchant acéré, en gouge, de

5- Hapchot testerin et bridon landais (Col. R.Aufan)
Cette
lame courbe permet de pratiquer dans l’aubier une entaille en creux, la care,
ce qui facilite l’écoulement de la gemme
S’y
substitue vers 1910, un outil plus simple, le « bridon », importé des
Landes, qui possède à l’opposé de sa lame tranchante un petit appendice dit
« place-bire » destinée à faire sur les bords de la care des
entailles où placer les « bires »
qui guident la résine ; celles-ci
sont le plus souvent constituées par un « galip » ou gemelle (le long
copeau qui a été enlevé de la care et qui servait traditionnellement
d’allume-feu naturel à tous les habitants).
 -
-
La première care ouverte au
pied du pin, le « basson », ou « bassot », se fait sur la
partie la plus robuste (la « teneille ») ; elle est orientée au
nord-est car les pluies arrivent de l’ouest. On utilisait ici, selon le gemmeur, soit une hache, soit le « hapchot ».
En effet, la longueur du manche du sarcle ne permettait pas le mouvement de
haut en bas.
6- Ouverture du basson au hapchot (Photo.
R.Aufan)
7-
Piquage au bridon (Photo
R.Aufan)

Ailleurs,
dans les Landes, on pouvait aussi
utiliser deux autres outils de forme différente et de sens inverse (maniés du
bas vers le haut), la petite pelle (ou
palot) qui permettait aussi de nettoyer le crot (Landes -1847),
La
deuxième année sa hauteur double c’est le « doubley ».
Le pin ne peut être
« mis en œuvre » que lorsqu’il atteint
Sa hauteur dépend des outils utilisés (pitey ou rasclet) et du statut des forêts : dans les forêts usagères (La Teste et Biscarrosse) où seule la gemme appartient au propriétaire du sol, le pin étant usager, il faut la porter plus haut pour exploiter l’arbre le plus longtemps possible.
|
1864 (Samanos) 1882
(La Teste) 1911 (Ricard [9]): Année 1 : 0,55 0,65 - 2 1,30 1,35 1,15 3 2,20 2,10 1,80 4 3,10 2,85 2,50 5 4,00 3,60 - 6 - 4,35 - |

9- Gemmage au crot
avec hapchot et pitey, en 1839
(in. Comte André de Bonneval :
« Tableau pittoresque des landes du bassin d’Arcachon »)
Le
résinier utilise donc un « pitey » que Thore en 1810 décrit
ainsi : une échelle d’une seule pièce aux coches en cul de lampe de 5 à
Le
plus grand pitey que je connaisse m’a été donné par Fernand Ballion dont le père, Alexis (1864-1938), résina les
pièces de La bat du loup et des Tioules en 1911. Il mesurait, car trop long
pour être stocké dans son hangar M.Ballion en avait coupé le bout…, 
10 - Résinier au pitey au début du XX° siècle
En
1825, un touriste bordelais[10]
en vacances chez Legallais[11],
qui visitait en arrière de l’établissement de bains la cabane située sur la
parcelle d’Eyrac, s’étonne de la façon dont les résiniers « se guindent –se hissent-
à chaque instant comme des écureuils…se servent admirablement de leurs pieds
nus dont ils font une espèce de pointe d’appui, tandis que la jambe enveloppe
l’échelle pour l’empêcher de glisser le
long de l’arbre »
Le pitey dont certains étaient équipés à leur sommet d’un crochet, ce qui facilitait sa stabilité fut ensuite abandonné et remplacé par un rasclet à long manche, signalé à La Teste dès 1904 par Durègne de Launaguet.
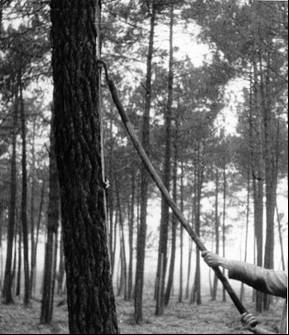

11- La
taille au rasclet (Photo. R.Aufan) 12- Evolution : du rasclet testerin au
rasclet landais (Col. R.Aufan)
Les
premiers comportaient une ou deux marches (comme pour le pitey) qui
permettaient de se hausser quelque peu le long de l’arbre pour utiliser le
hapchot. Mais le rasclet testerin ayant l’inconvénient de tordre le galip, sa
lame fut changée d’orientation afin
qu’il puisse glisser.
 Certains outils pouvaient
d’ailleurs, au gré du gemmeur, être équipés, comme le bridon, d’un place bire.
Certains outils pouvaient
d’ailleurs, au gré du gemmeur, être équipés, comme le bridon, d’un place bire.
13-Rasclet
avec place-bire (Col. R.Aufan)
Tous
ces outils étaient encore utilisés il y a une trentaine d’années, cependant des
tentatives de modernisation eurent lieu, en particulier l’utilisation d’une
« rainette ». Cet instrument auquel était annexé un vaporisateur
servait, selon la méthode américaine importée après la 2° guerre mondiale, à
pratiquer une petite care sur laquelle on aspergeait de l’acide afin
d’intensifier la production de gemme. Les anciens gemmeurs locaux l’utilisèrent
très peu mais les deux systèmes coexistèrent cependant (voir plus loin)
Tous
ces outils devaient être aiguisés avec beaucoup de soin. Pendant la journée, le
gemmeur emportait avec lui, dans une petite sacoche, des pierres à aiguiser,
appelées « agresses » par les originaires du pays voisin de Born. Il
utilisait aussi une espèce de rasoir à lame courbe, dit
« coupe-fer », pour redonner plus de mordant à l’outil.
Mais
c’était surtout le soir, au retour à la cabane, qu’avait lieu l’opération
destinée à donner du fil au tranchant (le talh) des outils
 On utilisait pour cela des pierres
de lest (ahile) sur lesquelles, après les avoir
mouillés, on frottait délicatement le métal, ces frottements provoquaient sur
la pierre, la formation d’une ou de plusieurs gouttières.
On utilisait pour cela des pierres
de lest (ahile) sur lesquelles, après les avoir
mouillés, on frottait délicatement le métal, ces frottements provoquaient sur
la pierre, la formation d’une ou de plusieurs gouttières.
Ces
pierres venaient de l’extérieur, en
effet, quand les bateaux testerins revenaient de Bretagne où ils avaient livré
leurs barriques de brais et goudrons, ils étaient obligés, s’ils n’avaient pas
de cargaison de retour (céréales…) de lester leurs bateaux avec des pierres
ramassées sur le rivage. Débarquées au port du « caillaou » (à l’abri
de la pointe de l’Aiguillon) ces pierres servaient à la construction des
maisons. 14-
C- La réception de la résine
Jusqu’à
l’apparition du pot, au milieu du XIX° siècle, la résine s’écoulait le long de
la care jusqu’au crot, petite fosse creusée au pied de l’arbre.
Les
descriptions en sont parfois confuses ; ainsi, en 1839, Bonneval dit
simplement que « la résine tombe dans un récipient placé au pied
de l’arbre », mais c’est ce système qui prévalait en forêt usagère de
Ailleurs il
semble que d’autres techniques furent utilisées : des pots en osier aux XV°
et XVI° siècles[12],
des auges en bois à Biscarrosse signalées par Monsieur de Caupos en 1755[13],
ou, à la même époque, des cornes de bœuf et des seaux en bois ( cités par
«
Plus tard, en
1839[15], avant
l'invention du pot en terre cuite, l'Administration des Eaux et Forêts (bien
qu’il ne s’agisse plus de la Montagne
mais des semis, cette notation est intéressante) prévoit que «si
l'adjudicataire a besoin de bois pour la confection des augets nécessaires à
l'extraction de la résine, il lui en sera délivré par l'agent forestier» .
Ces auges ou
augets n'étaient-ils que le crot tapissé de planchettes pour éviter la perte de
la résine comme l'affirme le Docteur Aparisi-Serres[16] ? Comme
le terme d'auge désigne simplement une «pièce de bois creusée»[17]
, ce peut donc être le pied de l'arbre, mais c'est aussi un récipient! Si
l'on s'en tient à la tradition, c'était un trou dont la paroi postérieure était
taillée verticalement dans le tronc de l'arbre et dont la forme générale était
celle d'un «angle dièdre», le plan antérieur étant oblique pour faciliter le
vidage à l'aide d'un outil appelé «pelle».
Pourtant en 1836,
Hector Serres utilisait le même mot d’auge pour les récipients en terre cuite
qu'il préconisait.

15- Pot, crampon et
bire (Photo. R.Aufan)
Y aurait-il eu déjà, au XVIII° siècle, dans le sud des Landes, des tentatives empiriques de rationalisation qui se seraient heurtées à la force des traditions et n'auraient pu surmonter l'archaïsme des méthodes locales ou bien les produits que l'on désirait obtenir, dans l'ancien système de gemmage, excluaient-ils, comme on le verra, l'emploi de récipients mobiles
Le pot en terre cuite vernissée fut en effet proposé en 1836 par le pharmacien dacquois Hector Serres puis mis au point par son ami Pierre Hugues qui en 1845 déposa son premier brevet.
Les pots les plus anciens
avaient un couvercle et un trou supérieur, pour passer le clou ainsi qu’un
trou opposé, parfois un bec, pour
l’écoulement de l’eau de pluie; ils étaient souvent recouverts d’un palot en
bois


16- Pot fixé par un clou supérieur
17- Pots
reconstitués antérieurs à 1860
(dune du Pilat R.Aufan)
trouvés sur
Mais le poids de la gemme rendait ce système d’accrochage très fragile, aussi en vint-on très vite au pot soutenu par un clou inférieur
D’après Dorgan[18]
en 1846, « ce système a déjà prévalu du coté de La Teste où l’on a
doublé la production »Cela ferait donc de La Teste un pays en pointe.
Pourtant dans un « rapport à la
société des propriétaires de
Cette déclaration, en contradiction avec le texte de
Dorgan me semble plus dictée par la polémique, ce qui est souvent le cas à La
Teste, que par la réalité du terrain.
Ailleurs
il y eut des difficultés à vaincre les habitudes : ainsi, au carnaval de Mont
de Marsan un pot fut-il attaché à la
queue d’un âne et les premières « résines Hugues »
n’apparaîtront qu’en 1858 sur le marché
de Dax[20]
soit 13 ans plus tard, tandis que, sur celui de Mont de Marsan, les deux types
coexisteront jusqu’en 1894 avec une différence de 12 francs sur la barrique de
Contrairement à ce qui se passait avec le gemmage au crot, où la résine coulait tout au long de l’arbre, perdant ainsi en qualité, le pot pouvait être remonté au fur et à mesure de l’allongement de la care.
Pour les pins très penchés, on utilisait un plat rond, posé sur le sol, dans lequel les gouttes de résine tombaient à la verticale.
Le pot a entraîné l’apparition du « crampon »
en zinc, dont les premiers exemplaires portaient 5 dents
pour mieux les fixer (et de la
« bire » pour les pins penchés), du
« pousse-crampon » et du « maillet de houx » (parfois de
chêne) ainsi que de la curette ou
« palinette » pour curer le pot
18- Palinette (Col.
R.Aufan)
19- Utilisation du
pousse crampon et maillet de houx
(Photo
R.Aufan)
---------------------  ---------------
---------------  ------------------------------------
------------------------------------
-------------------------------------- ----------------------------------------
----------------------------------------
20- Évolution du pousse-crampon et
plante-bire (Col. R.Aufan)
L’évolution
du « pousse crampon » va du complexe au plus simple :
A
l’origine, courbé, il est doté, sur sa face externe ou interne, de 3 pattes de
fixation pour glisser le crampon ; il n’y a donc pas besoin d’entaille
préalable. Ces pattes de fixation furent ensuite réduites à deux puis
supprimées.
Cela évitait de nettoyer l’instrument mais le pousse crampon ne servait plus qu’à faire une entaille préalable dans laquelle était, à la main, enfoncé le morceau de zinc.
Quant
à la fixation des bires (galip ou crampon droit) on utilisait pour l’entaille
un pousse-crampon droit : « le plante-bire ».
Un
autre instrument fut aussi inventé : « l’enlève pot à coulisse »
qui permettait d’aller chercher le pot installé sur les parties hautes
--------------------- -----------------------------------------------
-----------------------------------------------
21- Enlève pot (dimension
déployé : 3,30mètres Col.
R.Aufan)
22- Poches (Photo R.Aufan)
Plus récemment on essaya d’introduire des poches en
polyéthylène agrafées à la base de la care dans lesquelles la gemme s’écoulait,
un système de soufflet empêchant l’orifice supérieur de se refermer. Mais je
n’en ai vu utiliser qu’en dehors de
Dans le même temps, dans les
années soixante-dix, on expérimenta la
technique dite du « gemmage à l’acide ». Il s’agissait de vaporiser sur
la care de l’acide sulfurique diluée afin d’augmenter de près de 20% la
production de gemme et de diminuer le nombre de piques
23-  Rainette et
vaporisateur d’acide (Col. R.Aufan)
Rainette et
vaporisateur d’acide (Col. R.Aufan)
--------------------24-- ------------
------------
Le vaporisateur était équipé
d’un système de poignées actionnant deux
pattes qui, serrant la bouteille,
faisaient sortir un nuage
d’acide. Cela permettait au gemmeur de vaporiser de loin en limitant le risque.
Dans ce système, on n’entaille
plus l’aubier, la care n’est plus en
creux mais a l’aspect d’une surface plane. L’outil pour la préparer, la rainette, est donc à lame plate et
comporte, aussi, à l’opposé, un place-bire.
De même, le crampon en zinc prend une
nouvelle forme, il a un côté concave sur sa longueur ; il est alors surnommé « blieck » du nom
des vulgarisateurs du système. Les effets de cette technique, qui, selon
certains écologistes, pouvaient être négatifs
pour les oiseaux, n’ont pu être mesurés car le gemmage s’est arrêté
quelques années plus tard.
On essaya aussi des pots en matière
plastique mais je n’en ai jamais vu dans la Montagne.
D- Le transport de la gemme.
 25-Escouarte en châtaigner, Landes
début XX °s.
25-Escouarte en châtaigner, Landes
début XX °s.
Lors de l’amasse, toutes les
deux à trois semaines, le pot est vidé dans une « escouarte » en bois
de châtaignier puis, plus tard, en métal (La Teste) ou en chêne- liège dans sud des Landes. Le
cerclage supérieur étant aménagé de façon à y glisser la palinette.
Elle est ensuite vidée dans un « tosse » en
pierres ou en briques, plus tard dans un « tosse » en ciment,
creusés dans le sable et recouverts d’un toit en planches.
26-Tosse en forêt usagère (Photo
R .Aufan) 
Dans
les dernières années, certains fixaient leur escouarte sur une roue
de bicyclette afin d’en alléger la charge. Cet engin était appelé « la claudine ».
Le contenu était ensuite transvasé à l’aide d’une grande louche, le « cache », dans une barrique juchée sur le « bros » ou après la disparition de ces attelages, directement dans des barriques en bois, puis en métal,
disséminées dans la
forêt. 


27-Barrique (Col. R.Aufan)
28-Fût métallique et claudine (Photo R.Aufan) 30
Ces
barriques en bois de
Plus
tard ce furent des barriques métalliques qui furent utilisées
--------------------- ---------------------
---------------------
31- Tosse, cache, et barrique sur
le bros (Kaufmann 1891)
E- La dernière amasse :
Après
la dernière amasse, à la
mi-automne, on raclait la gemme solidifiée sur les bords de la care
(c’est le barras) à l’aide du « barrasquit » auquel, après l’invention du crampon, on adjoindra une « curette » destinée
à le nettoyer.
34
33- Barrasquit à curette

 ---------
---------  --------
--------
32-
Barras récolté (Ph.R.Aufan) (Col.
R.Aufan).
Pour
récupérer le barras sur les cares les
plus hautes on pouvait aussi utiliser
le « pousse » au manche
beaucoup plus long (

En forêt usagère, les pins ne pouvaient servir
qu’à l’usage ou au gemmage, seul profit du propriétaire du sol. C’est pourquoi
ils étaient gemmés jusqu’à épuisement et pouvaient ainsi porter plusieurs cares, voire en être entièrement
ceinturés quand ils étaient « gemmés à mort ».
Alors
les « ourles », nom donné à ce qui reste de bois entre deux cares,
sont fragilisées, éclatent et s’ouvrent, donnant au pin la forme si
caractéristique du « pin bouteille »
arbre emblématique de la Montagne qui sert souvent de nichoir.
Le
gemayre (gemmeur) devait se déplacer de pin en pin. Etant donné la rapidité
avec laquelle la végétation se développait, noyant souvent les sentes, il
utilisait un « sabre à fougères » et, pour
couper
les brandes, une sorte de faux «la dalhe » ou une serpe à long
manche, le « bedouch »
35

 36- Bedouch (Col. R.Aufan)
36- Bedouch (Col. R.Aufan)
38
 37- Griffes (Col. R.Aufan)
37- Griffes (Col. R.Aufan)
Certains, enfin, pour s’élever le long des pins
pouvaient se faire forger des griffes qu’ils attachaient aux jambes par des
lanières.
III L’utilisation des produits résineux.
A- Les témoignages anciens
Commençons
par les textes anciens.
Au début fut Ausone[22],
professeur, poète et homme politique bordelais (477-394). Il possédait un domaine boïen, près d’un étang (Cazaux ?) et faisait
négoce de poix et de résine. Il fut le précepteur du futur St Paulin, (dit
Paulin de Nole né à Bordeaux en 354, mort évêque de Nole en Italie en 431) qui,
dans une lettre, parla des « piceos boïos », des boïens hommes de
poix, c'est-à-dire fabricants.
Poix et résine étaient aussi utilisées par les bituriges vivisques
(peuplade celtique qui, au III° siècle AC, fonda
Bordeaux - Burdigala), pour infuser le vin.[23]
En 1581, Jacques Auguste De Thou, conseiller au Parlement de Paris,
profite d’une mission à lui confiée par le Roi Henri III pour faire une
escapade touristique et gastronomique sur les bords du bassin. Dans ses
mémoires[24]
il raconte ce repas d’huîtres et parle du « rivage
de la mer bordé de pins très élevez, dont on tire la poix ou la réfine…Du temps d’Ausone on donnoit le nom de Buchs
& Bayonnois aux habitants de ces côtes ; pour lui, il les nomme tantôt
Buchs & tantôt Poissez, fans doute par rapport à la poix qu’on
tire de ces pins dont l’écorce fournit encore de nos jours à ces peuples de
quoi se chauffer et s’éclairer ». De Thou
fait ici allusion à Paulin de Nole car on a parfois traduit son expression par
« poisseux » et confond d’ailleurs les produits tirés du pin.
Par
contre, en 1616, les Lettres patentes du Roi[25]
parlant des « manans et habitants de
la juridiction de La Teste de Buch et Hâvre d’Arcasson », disent « qu’ils ne recueillent aux dittes
montaignes que les poix et résines dont ils font trafic et qu’ils peuvent
transporter (sans payer de droits) ez
lieux de Marensin, Buch, Médoc, Born, Landes ,Nérac, Bazats, Condom, Mezin
(près de Nérac), Casteljaloux, Bourriac, Gaurrec, Dax et autres lieux
circomvoisins au dit lieu de La Teste ». Ce texte prouve non seulement
l’activité de production des Montagnes de La Teste, mais aussi le négoce
important auquel se livraient les bourgeois et armateurs locaux exportant, par
La Teste, les produits résineux landais.
En
1669, Claude Perrault, médecin, architecte et frère de l’auteur des Contes,
effectua, du 9 au 12 Octobre, une visite à La Teste[26]
. Il la raconta dans son « Voyage à Bordeaux » et
précisa : « dans ces
forêts de pins, il y avait de tous temps des manufactures pour les résines de
ces arbres qui s’y en prennent et découlent comme la térébentine, le galipot,
l’encens ou qui se font par la cuisson du galipot comme la poix noire de la
résine… » Dans ce texte assez imprécis quant aux techniques, il faut
prendre le terme de manufacture au sens premier de travail fait à la main.
Lombard en 1672 est assez évasif, il
parle de « distiller » la résine, précisant que « par
le moyen du feu, la chaudière la réduit en diverses sortes de
marchandises toutes d'un prompt débit ».
Masse[27]
en 1708 est par contre plus explicite :« Quand
ils ont amassé une grande quantité de cette gomme, ils la font bouillir dans
des chaudières, ensuite de quoi elle est assez cuite, ils la font couler
avec une petite dalle dans des trous qu'ils font dans le sable pour en faire
des pains ronds d'un pied ou deux de diamètre sur dix huit à vingt
pouces de hauteur, plus ou moins selon l'idée des ouvriers. Quand elle est
séchée et dure, on la rompt par morceaux et se vend à la livre. Elle sert à
faire le brai dont on enduit les vaisseaux de mer et d'eau douce
tant pour empêcher la pourriture, boucher les trous, que pour empêcher que le
vaisseau ne sèche par l'ardeur du soleil .Cette résine sert à plusieurs autres
usages en la faisant cuire davantage. »
Quant à M. de Fenelon[28]
en 1709 il
décrit ainsi les opérations : On a le
soin de la ramasser tous les mois ou dès que le creux est plein. Aussitôt qu'on en a une quantité
raisonnable, on la fait cuire dans des chaudières de cuivre
faites exprès, pendant l'espace presque d'une journée, dès que la cuite est
faite, on verse cette matière dans un grand arbre qu'on a creusé comme une auge
et on y mêle de l'eau qu'on bat quelques temps ensemble et, le mélange étant
fait ,on fait couler cette liqueur dans des creux qu'on a eu le soin de faire
dans la terre grands ou petits selon la grosseur des pains de résine qu'on veut
faire."
Le
grand arbre creusé en auge est un « couladuy » le système est
déjà attesté à La Teste en 1623[29].
Enfin
en 1786, l’abbé Baurein[30]
écrit : « il y a dans cette partie de la forêt de pins (dans la
paroisse de Cazaux) 40 fours à résine,
12 servant à faire de la gemme, du
goudron, du brai sec, qui tous appartiennent à des gens étrangers à la
paroisse. »
Il faut se rappeler qu’à cette époque, le pot n’existait pas.
Quant au Cahier de doléances de La Teste, en 1789, il revendique
le maintien des exemptions fiscales pour le transport de « leurs gommes résineux comme térébentines, brais gras et sec,
résines jaunes et goudrons »
Tous ces produits évoqués parfois maladroitement mais dont la production est attestée localement depuis l’époque gallo-romaine doivent être reclassés en produits bruts ou produits cuits
B- Les
produits bruts
1-
La gemme au crot, le galipot et le barras.
La gemme au crot était récoltée puis utilisée
telle quelle ou bien cuite ou encore exposée au soleil. Remarquons une
différence essentielle entre le gemmage avec pot, dans lequel on récolte
surtout la résine molle
destinée à être distillée, ce qui n’advint qu’à partir du milieu du XIX°
siècle, et le gemmage antérieur, au crot. Dans ce cas, la gemme qui doit descendre jusqu'au
pied de l'arbre se solidifie en coulées blanchâtres le long de la carre dont
on la retire avec un instrument appelé barrasquit. Elle porte alors le nom,
selon sa qualité et la durée de son séjour sur l'arbre, de galipot ou de barras, appelé, au XVII° « gomme blanche ». Ailleurs, au XVIII°, on la nommera «encens blanc» (1755) ou «poix de Bourgogne».
2- La résine molle
La résine molle
récoltée dans les temps anciens sous le nom de poix blanche s'écoulait donc jusqu'au pied de l’arbre.
Ce produit très
appauvri en essence, à cause de son long séjour à l'air, était beaucoup moins
utilisée faute d'un appareillage de récolte spécifique : il s'écoulait dans un crot d’une capacité d’un
demi-litre, et servait cependant, après filtrage sur des claies de
paille et cuisson à la chaudière, à produire une térébenthine plus riche
en essence.
En 1810, le
rendement de 3.000 pins était ainsi de 8 à 10 barriques de résine molle, ce
qui, en prenant comme référence la barrique de
3
Le franc encens,
Les premiers
témoignages notariés sur ce produit remontent à 1497, il fut l'objet, à
Bordeaux, de chargements épisodiques dans la première moitié du XVI° siècle[31]. Cette
extrême rareté s'explique par son origine. Lombard la décrit très bien en 1672
: c'est le pin «arrivé à la décrépitude qui, dans la fin, ouvre son tronc
d'où il se tire encore de l'encens suave et aromatique qu'on mêle pour
augmenter celui d'Orient» et que «les droguistes recherchent avec
empressement pour en faire des voitures - des expéditions - considérables».
Une autre raison
de sa rareté tient dans le fait que les pins arrivés à décrépitude dans les
Montagnes usagères de La Teste et de Biscarrosse, les plus grandes zones de
production, étaient réservés aux habitants comme bois de chauffage. Cela
explique la faiblesse des exportations : 0, 14% du total des résineux
chargés à Bordeaux de 1493 à 1520 ou 3,4 tonnes en 27 ans.
4 La tormentine de soleil
Le produit
essentiel était donc le galipot qui était ensuite transvasé dans un « barque »
afin d'obtenir la tormentine ou térébenthine de soleil. La
description la plus ancienne du barque fut donnée en 1810 par le docteur
Thore et fut souvent reprise.
 39- À
droite le puits et la cabane appartenant à M. Lalesque, à gauche, un peu plus
loin, le barque (AM Bordeaux)
39- À
droite le puits et la cabane appartenant à M. Lalesque, à gauche, un peu plus
loin, le barque (AM Bordeaux)
En 1825, le
touriste dont nous avons déjà parlé, s’arrête, au bas de l’escalier conduisant
à Notre Dame d’Arcachon, « à
côté d’un puits devant une grande caisse où l’on porte la résine. De cette
caisse, dit-il, coule naturellement à
travers le plancher, une liqueur très épaisse et très odorante qu’on appelle la
thérébentine de soleil. C’est la meilleure et la plus estimée, on la reçoit
dans de grands vases de bois de pin creusés à cet effet. » En 1848 la
« caisse » était toujours là, dans la parcelle appelée
« Bos », sur la gauche de l’allée dessinée par Léo Drouyn.
En 1829, Gustave
de Galard, dans une lithographie où la résinière est représentée de manière
idyllique, nous en a, lui aussi, donné une image fidèle et, puisque
l'Encyclopédie en parle au XVIII°
siècle dans les mêmes termes, on peut penser que la même technique était
utilisée auparavant.
 40-Gustave
de Galard : le barque
40-Gustave
de Galard : le barque
Il s’agit, comme
dans l'Antiquité, d’exposer la gemme au soleil afin que s'en évapore «l'huile
essentielle ». En 1559[32] et 1576
[33]on
précise, dans des actes notariés, «tormentine
non cuite à la chaudière»
Les chargements
de cette tormentine au départ de
Bordeaux sont fréquents: même si cela
ne représente entre 1500 et 1520 que 134 tonnes, soit 5,53% du total des
résineux exportés.
Le terme de barque apparaît aussi dans les actes
notariés : en 1596[34], 1623[35] et 1657[36] , des
barques sont ainsi mentionnés dans des actes de vente en forêt de
Ces
barques étaient des réservoirs en madriers de pin de 2 à 2,5 mètres
carrés. Ils avaient un double fond : l'un, supérieur, était horizontal et
ajouré afin que le produit s'écoule entre les madriers disjoints ;
l'autre, inférieur, légèrement incliné -
Recouvert de
planches, ce réservoir était exposé en plein soleil, rempli de galipot, si bien
que, sous l'action de la chaleur, une liqueur rousse, la tormentine, se
dégageait et coulait sur le plan incliné jusqu'à une auge extérieure d'où elle
était transvasée dans des barriques entreposées ensuite chez les négociants de
Comme les techniques évoluent peu, on peut
même imaginer que les entrepôts du XVI° siècle étaient semblables à ceux des
Testerins de 1810 : des barriques stockées sur deux plans carrelés et
légèrement inclinés vers un canal central afin de récupérer la liqueur suintant
entre les douelles, la térébenthine dite alors «de Venise».
C'est ce type de magasin qui est évoqué dans la location par Guillaume Desbiey (1725-1785)
responsable en 1772 des fermes du Roi à La Teste [37], au lieu dit Lavie, à La Teste, d'une maison dont «le
chai à bois est attenant au magasin haussé pour les térébenthines»[38]
Cette tormentine,
utilisée pour la fabrication des vernis, des solvants, des cires à cacheter,
était le plus important des produits tirés du pin vif
C Les produits cuits
Mais après la
séparation du galipot et de la liqueur, restaient, au fond du barque, des
résidus. Ceux-ci, mélangés avec du barras et de la gemme non filtrée, étaient
cuits dans une chaudière, la caoudere ou caudeira, et donnaient d'autres
produits.
1 Les térébenthines cuites à la chaudière.
Il s'agit d'un
sirop doré, issu de la cuisson du galipot et de la résine molle ce qui, dans ce
dernier cas, donne une substance plus chargée en essence.
2
La rousine ou brai sec.
Appelé plus tard arcanson
ou colophane, vendu en pains de 150 à 200
livres-poids, ce
produit servait à fabriquer les vernis, peintures, papiers mais aussi à enduire
les cordes des instruments de musique, et surtout au carénage des coques de
bateaux. Cette utilisation dans le carénage explique l'importance des
expéditions de résine et rousine dans la période 1497-1520: 91,2% des exportations,
voire 94% si l'on y ajoute la «gemme en foyer» soit 2282 tonnes.
C’est
certainement ce produit qui fit l’objet du fermage[39] accordé
en 1777 par Nicolas Taffard, Conseiller à
Les fours ou les
chaudières en cuivre (caoudeyres) servent indistinctement pour cuire le brai ou
la poix ainsi aux Courpeyres en 1815 ou au Courneau en 1835.
3 Le brai clair ou résine jaune.
Il est obtenu après deux heures de cuisson suivies
d'un mélange avec de l'eau dans un tronc de chêne évidé, le couladuy[41]
, afin de l'éclaircir. Utilisé dans la savonnerie, l'encollage du papier,
on l'emploie aussi pour vernir les mâts et superstructures des  navires.
navires.
41-Gustave
de Galard 1835 (la composition est située sur les bords du basin représenté au
fond).
Un
atelier :
-à
droite le couladuy ;
-derrière
la fumée, un four à goudron ;
-plus loin le barque à tormentine ;
-contre
le pin, un résinier sur son« pitey » s’élève le long du pin pour
le gemmer.
4 L’huile de térébenthine.
Il s’agit de la liqueur rousse obtenue
dans les barques, seul système attesté en Buch, en particulier par Rostan,
qu'on peut qualifier de procédé de distillation naturel, la chaleur solaire
permettant de séparer du galipot une térébenthine plus pure qui
s'écoule par le bas.
Pourtant les alambics
de distillation pour obtenir l’essence de térébenthine existent depuis déjà
longtemps : dès 1709 en effet
Cette huile
figure encore en tant que telle dans les comptes d'exportation pour l'année
1717 à destination de l'Angleterre, de
Il y avait donc au XVIII° siècle distillation
en alambic, c'est ce qu'atteste d'ailleurs l'abbé Desbiey qui distingue la térébenthine au soleil,
la térébenthine à la chaudière au feu ordinaire, l'essence grasse
qu'on recueille sans alambic en faisant cuire la résine molle et enfin l'essence
de térébenthine distillée à l'alambic.
 42-(Il
s’agit vraisemblablement du Hourn Somart ou de Labat de Ninot )
42-(Il
s’agit vraisemblablement du Hourn Somart ou de Labat de Ninot )
Mais ces techniques ne sont pas
encore utilisées à La Teste ce que,
après l’abbé Baurein en 1786, confirme Thore. Il précise en effet que la
térébenthine de soleil n'est obtenue qu'à La Teste et dans ses environs où il
n'y a pas d'atelier de distillation. D’ailleurs même après la création des
distilleries, on continuera, comme l’attestent, vers 1850, les dessins de Léo
Drouyn, d’y faire de la térébenthine de soleil.
Il y a donc eu, pendant toute la
première moitié du XIX° siècle, coexistence entre les ateliers
« urbains », les distilleries et fabriques
du bourg, et les ateliers forestiers, les premiers
prenant le dessus avec l’apparition des « machines à vapeur » dont la
première est autorisée en 1864.[43]
D- Tableau
des produits tirés du pin vif-43-
-----------------------------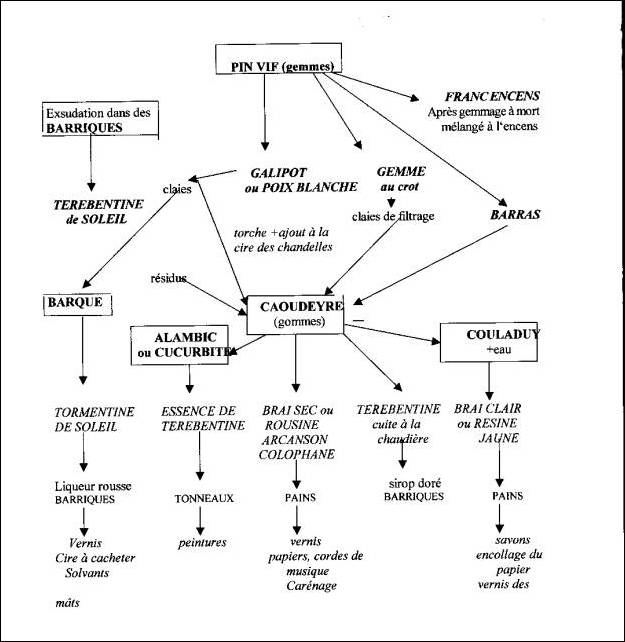 ----------
----------
Tableau des produits tirés du pin vif et de leur utilisation (R.Aufan)
Le
tableau ci-dessus reprend les différentes techniques qui étaient donc utilisées
aux XVIII° par les « arrousineys »,
fabricants de rousine et de produits cuits dont la traduction française a donné
improprement le mot « résinier » alors que, on l’a vu, celui-ci
aurait dû garder le nom de gemmeur.
Mais
une autre catégorie de produits étaient obtenus à partir du pin mort, ce sont
les pègles, poix noire, brays gras et goudrons.
IV
Les produits résineux tirés du pin mort
Depuis l’Antiquité,
certaines parties des pins, une fois abattus, ont toujours été utilisées pour
fabriquer des produits appelés ici poix, pègle ou goudron de caillou, ailleurs
goudron subtil ou coulant.
A- Les techniques de fabrication
1-
Les témoignages anciens
Comme précédemment, même si, en ce qui concerne les
utilisations, il mélange un peu les produits, Claude Masse, en
Ce texte décrit un four à goudron tel que, d’après l’auteur, ils furent introduits en 1660 par des suédois. Mais cette description pourrait très bien convenir pour les fours traditionnels utilisés depuis très longtemps dans la montagne de La Teste ce que Masse semble ignorer puisqu’il dit qu’avant cette date on tirait le goudron des Pays du Nord.
2-Fours suédois ou hourns
traditionnels ?
Il
est exact que le premier four « suédois » ou « hourn de
gaze » fut construit en 1663, sous la direction du sieur Lombard, dans la
forêt de La Teste, sur une parcelle appartenant à Monsieur de Caupos appelée
« Sanglarin » près de la pièce des « Deux Hourns ».
L’emplacement de ce four, que Lombard a décrit en 1672, a été retrouvé mais l’installation n’existe
apparemment plus.
Il s’agissait d’ «un bassin en
forme de pain de sucre renversé ayant en sa superficie quatre toises de
diamètre et une toise et demie de profondeur», duquel partait «un canal pour conduire le goldron dans le
réceptacle». Dans cette cavité fut disposée la valeur de «vingt charretées de bois de pin mort et du
plus sec...réduit en billes de trois pieds de long» autour d'une «grande perche toute droite en forme de
bourdon ». Ce bassin était «pavé
de carreaux ou parement de brique cimenté avec de la chaux, terre grasse et
bien jointoyée». Une fois rempli, il fut recouvert de gazon puis le feu y
fut mis «tout ainsi qu'à une
charbonnière». «Pendant trois jours
et deux nuits le bois s'est consommé à écouler la matière» et «le premier essai a rempli 12 barils de
goldron bien coulant».

44-Hourn de gaze, méthode suédoise, dessin de
Desbiey (XVIII siècle)[44]
Comme je l’ai montré dans l’ « Histoire des
produits résineux landais »[45]
les auteurs régionaux qui ont suivi, ont tous, peu ou prou, repris le même type
de description : le bordelais Monsieur de Fenelon en 1709, le Commissaire
des classes de
On
produisait pourtant du goudron dans la forêt de La Teste à preuve la toponymie :
le nom de Hourn Peyran apparaît dans un acte notarié en 1500 ( il est possible que ce four soit celui que nous
avons retrouvé sur le flanc ouest de la dune du Pilat), Les Deux Hourns en 1521[47],
le Hourn Laures en 1639, le Forn Somard (près des Abatilles) en 1559[48]
, à preuve aussi les ventes de parcelles comportant des fours ou encore les
pièces de monnaie que j’ai retrouvées à l’emplacement de certaines fouilles
(1641 à 1650 à Mouréou, 1558 à 1650 au Pilat)
Mais
la forêt étant usagère, les « ayant-pins » ne disposaient pas, sauf
en cas d’incendie ou d’ouragan, de beaucoup de bois pour fabriquer du goudron. C’est ainsi qu’après l’ouragan du 11 Frimaire An X (2
décembre 1801) [49]
qui abattit 1270 pins dans ses parcelles des Estageots et des Montauzeys,
Taffard de
C’est pourquoi cette technique fut, comme l’écrivit Desbiey en 1776, abandonnée dans les forêts usagères de La Teste et de Biscarrosse, où subsistèrent longtemps des goudronnières dont la capacité, constatée par le suédois Elia Alh en 1666 était « faible et médiocre » ce que confirmait Desbiey en 1776 disant que les fours de La Teste, dans lesquels on fabrique du goudron sont « trop resserrés » et sont « naturellement destinés à l’extraction de la poix ou pègle dans la langue du pays ». Cette pègle, de moins bonne qualité, était d’ailleurs entre 1757 et 1779[50] vendue au 2/3 du prix du goudron
N’ont donc fonctionné localement du XVI°
au XIX° siècle que des "hourns traditionnels" destinés surtout
à brûler les résidus du gemmage pour obtenir des poix, pègles, goudrons de
caillou (terme créé en 1810 à cause de l’utilisation de la pierre comme matériau
de construction) et bray gras même si, d’après le rapport Lombard, une dizaine
de fours « suédois » furent construits entre 1663 et 1672 aux
lieux-dits Sanglarine, Nottes, Batsegrètte, Boy, Labat de Quité, Menoy,
Galouneys et Taulette. Mais ces constructions furent éphémères puisqu’en 1686,
sur tous les fours en activité au temps de
Cependant il est fort probable que certains d’entre eux
furent réutilisés ou que de nouveaux furent construits quand la quantité de bois utilisable fut importante, ainsi la perte de
Certains
continueront à être utilisés pour la
fabrication du charbon de bois comme, on le verra, celui de Sanglarine en 1844.
3-Les techniques au XVIII° siècle
Le tableau ci- dessous
explique les deux techniques utilisées dans la région landaise au XVIII°
----------------------------------- ---------------------------
---------------------------
Ces mamelons étaient en
pierre, garluche le plus souvent, grès
fossilisé constitué de sable et d’oxyde de fer, avec
parfois des pierres de lest apportées par les bateaux, (comme au Pilat). Ils
avaient, dans la partie supérieure, un foyer creusé en entonnoir dans lequel
étaient disposées les bûchettes. En partait
une canalisation interne qui, à ciel ouvert, se dirigeait ensuite vers un
réceptacle extérieur.
Celui du Pyla avait, sur le
côté est, un conduit qui devait servir à l’allumage puis à l’oxygénation du
foyer. Sur les autres fours le conduit était remplacé par des orifices latéraux
beaucoup plu petits.

50-
« Le Pilat : conduit d’ d’allumage et d’oxygénation »
(R.Aufan 1981)
Certains de ces fours
étaient, à l’ouest, protégés des
vents dominants par un mur
 ------
------ -----
-----
51- Mur ouest du four de Baillon) 52-Louche (Le Pilat ; collection R.Aufan) 53- La cuve de
combustion du hourn du « Becquet» La Teste de Buch
(-photos R.Aufan 1977
Le foyer, après remplissage, le canal et le réceptacle
étaient recouverts d'un mélange d'argile et de débris de tuiles puis découverts après la
cuite.
Une
fois le goudron du réceptacle vidé à l’aide d’une louche et le foyer nettoyé du charbon de bois résiduel, les voûtes étaient, après remplissage, reconstruites
pour la cuite
 54-Mamelon de charbon de bois en arrière du four du Pilat.
54-Mamelon de charbon de bois en arrière du four du Pilat.
(Photo. R.Aufan 1981)
Le
charbon de bois était ensuite répandu dans les environs du four (Mouréou,
Baillions, Batlongue-les Nègues) ou stocké (Pilat) autour de
l’installation
55-L’étanchéité du réceptacle de Baillons
maintenue
après plusieurs siècles (photo R.Aufan
1978)

L’intérieur
du foyer était tapissé de briquettes ou de carreaux
de
terre cuite jointoyés à l’argile. Celle-ci pouvait venir des
braous
les plus proches ou, pour les sites voisins des
côtes,
des
couches d’argile,
actuellement recouvertes, qui
affleuraient
à l’époque, le niveau de la mer étant plus bas.
Ces
opérations longues et complexes faisaient que la production restait artisanale et domestique.
---
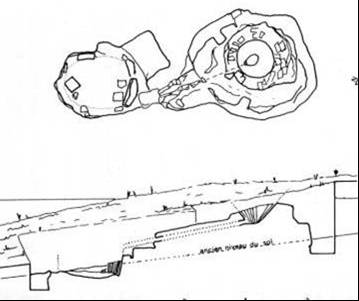 --
--
56-Hourn traditionnel de “Mouréou” LaTeste1980 (Photo R.Aufan)
57-Plan et coupe (J.Seigne)
Dans ces installations le réceptacle est toujours
désaxé par rapport au four. Il faut en effet veiller à ce que, dans la partie
enterrée du canal d’évacuation, le
goudron reste toujours bien « coulant ». On y passe pour cela une tige de fer rougie au feu à laquelle on
imprime un mouvement de va et vient ; pour effectuer ces manœuvres, il
faut donc un espace, dans l’axe du four.
Quant
à la canalisation, elle est constituée de tuiles renversées ou bien elle est
creusée dans une assise de pierre et, pour pouvoir effectuer le débouchage, la
partie la plus proche du four est découverte.
Outre
les sites que j’ai fouillés (Le Becquet qui existait déjà en 1775, Mouréou, Le
Pilat- Hourn Peyran, Baillons, le Jaougut), j’ai pu en repérer d’autres (Le
Brana, Laouga[54],
Batlongue) tandis que la toponymie (Le Hourn Laurès) ou les archives indiquent
d’autres parcelles (Courdeys de haut, Petnau, Les Estageots, Les Courpeyres,
les Montauzeys).
Pour
avoir une idée plus précise de la taille de ces installations, j’ai reproduit
ici la synthèse des mesures obtenues (en mètres) lors des
fouilles effectuées en forêt de La Teste ou de Biscarrosse (Vincent) qui à
l’époque n’en faisaient qu’une.
---------------------------58- ------------------------
------------------------
B- L’utilisation des produits[55]
Sans prêter foi aux rêves de
Phéniciens venus sur nos rivages chercher poix et résine, ni aux étymologies
qui tentent de relier Arcachon, pays de l'Arcanson ou colophane, avec la ville
ionienne de Colophoon qui est à l'origine de ce mot (alors que le lien entre
Arquasson et cass-anus évoquant la chênaie-pineraie ancienne est plus
vraisemblable), on a, on l’a vu, depuis les boïens, toujours fabriqué et
utilisé chez nous ces poix-goudrons.
1
L'étanchéité.
La poix enduisait, il y a peu, en Pays de Buch, les bâtiments, cabanes, chais,
hangars construits avec le bois de la Forêt Usagère, protégeant ainsi le
matériau de l'humidité, comme c'était le cas dans l'Antiquité et comme ce le
fut aussi dans toute l'Europe médiévale.
Ces produits résineux
avaient aussi servi à l'étanchéité des
récipients, amphores, outres en cuir, tonneaux de bois .Cette utilisation s'est
perpétuée jusqu'à nos jours puisqu'en 1917, à Beliet, c'est la poix noire, goudron
issu de la combustion du pin mort, qui est achetée pour servir au «colmatage des fûts de bière »[56] .On
trouvait déjà cette tradition dans l’Antiquité ainsi qu’au Moyen Age puisque au
XIIIe siècle, le «Livre des Métiers» nous apprend qu'on ajoutait,
pour «efforcer la bière…, baye, piment et pois résine». On pourrait
encore citer le revêtement interne des gourdes en cuir du Pays Basque, enduit
résineux qui donnait un goût au vin tout en assurant l'étanchéité de
l'enveloppe.
2 La pharmacopée
Les usages médicaux très fréquents de la poix dans
l’Antiquité (épilation, dermatologie, ulcérations, maladies respiratoires et
nerveuses…) se sont perpétués : au XV° siècle, Ambroise Paré utilise des
emplâtres constitués de poix liquide et de poix noire, et plus près de nous, en
1880, l'Officine, Répertoire Général de la Pharmacie Pratique, préconise les
goudrons végétaux de Norvège ou des Landes pour les gales, lèpres, psoriasis,
porrigos, furoncles, catarrhes vésicaux, gastrites et phtisies pulmonaires.
Un peu plus tôt, le docteur Lalesque[57]
préférait aux appareils britanniques « propres à faciliter les émanations
goudronneuses» appelés «boîtes à goudron ou goudronnières», les
cures libres dans les pins d'Arcachon, station climatique et médicale réputée
pour soigner, grâce aux «senteurs balsamiques et térébenthinées», les
scrofuleux, les tuberculeux et les nerveux .
Les vieux résiniers nous ont enfin confié l'action
bénéfique de la poix pour cicatriser les plaies occasionnées aux mules par
leurs colliers, tandis que d’autres se souvenaient de son utilisation pour
extraire les échardes de leurs pieds souvent nus et de son effet bienfaisant
contre les rhumatismes.
D'ailleurs, l'officine Durvaut, manuel de
pharmacopée, préconise toujours à notre époque le goudron de pin purifié pour
les sécrétions bronchiques sous forme de capsules, pilules ou sirops de
goudron. Elle mentionne encore les goudronnières anglaises, le recommandant
aussi en applications externes contre l'eczéma sec, la séborrhée du cuir
chevelu et le psoriasis, ou bien dans les affections des voies urinaires. Quant
aux vétérinaires, il leur est toujours conseillé d'utiliser contre les
affections de la peau et les parasites le liquide « fluide, brun et
empyreumatique» qui, après la distillation per descensum, surnage
au-dessus du goudron.
La poix-goudron fut donc bien un «remède-miracle» de
l'Antiquité jusqu'à nos jours !
3 La construction navale
Il en est de même pour ce qui concerne la
construction navale où les goudrons, poix et brays gras ont été de tout temps
indispensables jusqu'à ce que les coques métalliques, puis plastiques, et les
produits chimiques, ne viennent les supplanter.
Bray épais coulé à chaud pour boucher tous les
intervalles entre les pièces de bois, à l'intérieur de la carène, pour assurer,
outre le collage, l'étanchéité de l'ensemble ; utilisation par les
« calfats » d'étoupe goudronnée pour garnir les joints et interstices
des bordages de la coque ; ou, une fois les bateaux terminés, enduit de la coque extérieure de
goudron végétal fin tant chez les Grecs
que chez les Romains,
En
Buch, cela nous fait penser à la «pinasse»,« noire du colta d'autrefois
» que célébrait le poète testerin Gilbert Sore[58],
à ce« pinus », comme auraient dit ses lointains maîtres Virgile et
Horace , lui aussi « coltaré » comme tout ce qui était en contact avec l'eau.
Remarquons au passage que si Gilbert Sore précise « colta d'autrefois », c'est
qu'il pense bien au goudron végétal et non au coltar-coaltar, de l'anglais
coal, goudron de houille, apparu au XIX° siècle. C’est en effet en 1845 qu’ouvre à Bouliac près de Bordeaux, la première
usine de « goudron de houille »
Ces coques coltarées, brayées, comme on disait à
Bordeaux au XVI° siècle, devaient être
régulièrement raclées et les anciens récupéraient d'ailleurs ce vieux goudron
pour, le réduire en une poudre qui servait encore à résorber les abcès.
Mais les coques n'étaient pas les seules à recevoir
la bienfaisante poix, voiles et cordages aussi en étaient imprégnés, c’est
d’ailleurs pour alimenter la corderie royale de Rochefort, qu’on tenta, on l’a
dit, en 1663, d’introduire, sans succès, dans la forêt usagère la technique
suédoise du hourn de gaze, qui se développa en Born et Marensin dans des forêts
non usagères où le bois était abondant.
Les cordages, après avoir été desséchés dans une
étuve, y étaient goudronnés par immersion dans une chaudière en cuivre rempli
de goudron chaud puis placés sur un égouttoir. Si leur résistance aux tractions
était moins forte que celle des cordages « blancs », elle était plus
grande pour ceux qui devaient passer de l’eau au sec.[59]
Cette activité de construction navale qui était localement très ancienne fut
florissante au XVIII° siècle, comme en témoignent les deux tableaux ci-dessus,
l’un concernant le nombre de bâtiments du quartier de La Teste[60],
l’autre les professionnels utilisant ces produits.
----- -----
----- ----
----
59- Bâtiments du quartier de La Teste
1719-1791 60- Professionnels de la construction navale
(1725 – 1813)
On constate une forte proportion de petits
bâtiments, chaloupes non pontées de 10 à
On constate aussi que sur ces 74 années où furent
construits 198 bâtiments,
20 se passent sans aucune construction, 23 avec une
seule et que les années 1760 et 1763 connurent 10 lancements. La moyenne des
années restantes s’établit donc à 6 par an, ce qui est peu, pour occuper tous
les professionnels de la construction navale.
Les bateaux testerins avaient, en effet, une durée
de vie importante, et quand ils ne cabotaient plus (2 à 3 voyages par an) ils
étaient à la pêche. L’entretien de ces flottilles était donc important d’autant
qu’il faut y ajouter les bateaux non immatriculés, le traitement des cabanes et
de tous les édifices en bois des paroisses riveraines.
En 1725 le commissaire
Rostan signalait 800 pinasses construites à clin, système dans lequel les
bordages se recouvrent l’un l’autre, servant pour la pêche à l’intérieur du
bassin, qu’il fallait aussi « brayer », auxquelles il ajoutait 13
barques de 12 à 20 tonneaux et 13 chaloupes pour la pêche en mer. Accrue par
l’abondance de bois due à l’incendie de 1716, la production de brays, poix et
goudron devait alors avoir assez de débouchés entre le bassin et Bordeaux et
les autres ports.
4-Importance économique.
Les produits résineux n’étaient pas consommés que
sur place, ils étaient exportés soit directement par le port de La Teste (qui
commercialisait aussi les produits venus du nord des Landes) soit par Bordeaux[61]
 61-
61-
● Cabotage testerin de février à Décembre
1780
(2)
nombre d’escales
□
Cabotage testerin entre 1780 et
1817
1- nombre d’escales
Le port comptait alors une trentaine de négociants
au lieu de 3 au début du siècle et des
armements eux aussi en augmentation (42 de plus de 8 tonneaux entre 1771
et 1791 contre 12 entre 1712 et 1729.
Comme on le voit sur cette carte,[62]
les exportations vers
62-Les exportations de résineux à partir du port de La Teste à la fin
du XVIII° (R.Aufan)

La forêt générait
donc une grande activité comme en témoigne cette dernière statistique
concernant la période révolutionnaire[63] :
1780/89
1796
Résiniers et charbonniers 35 95
Charpentiers de navire 4 8
Cordiers
2 4
5- L’importance de la production au XVIII° siècle
Que produisait
Au XVIII° siècle, une seule source est détaillée,
-la déclaration des « propriétaires » de
1751 à propos de l’affaire des fenêtres[65],
qui indique une production de 1500 milliers, soit 15000 quintaux
Etant
donné qu’à cette époque 40 pins sont nécessaires, en moyenne, pour obtenir un
quintal de résine,( chiffres avancés par Villers en 1778[66])
cela donnerait une estimation de 600000 pins exploités
On
voit à ce seul exemple combien il est difficile de se faire une idée car en
extrapolant, d’après le nombre de tiges à l’hectare soit environ 143, cela nous
donnerait, pour un massif qui, avant le grand incendie de 1716 représentait
près de
Cela
paraît logique car il n’y a plus que la partie testerine , l’incendie ayant « coupé les deux montagnes »[67]
Pourtant, les calculs effectués d’après leurs dires (une
fenêtre de
Cet exemple montre bien la difficulté qu’il y a pour
estimer la superficie du massif er donc sa production
C- L’évolution de la production aux XIX° et XX° siècles
1- Les ateliers testerins.
Il y a eu, on l’a dit, pendant toute la première
moitié du XIX° siècle, coexistence entre les ateliers « urbains »,
les distilleries et fabriques du bourg et les ateliers forestiers, les premiers
prenant le dessus avec l’apparition des « machines à vapeur » dont la
première est autorisée en 1864.
L’évolution de la construction navale (fer puis de
nos jours plastique) , l’apparition des produits chimiques (première entreprise
fabriquant du goudron de houille à Bouliac en 1845[69],
première fabrication de coaltar d’origine pétrolière en 1855 à Cenon)[70],
la mise au point de nouveaux produits pour assurer l’étanchéité, y compris dans
la construction en bois traditionnelle, ont donné un coup fatal aux productions
traditionnelles même si, on l’a vu, quelques ateliers artisanaux se maintinrent
assez longtemps en forêt.
Si l’activité fut encore importante durant tout le
XIX° siècle, elle se déplaça de la forêt vers le bourg où les ateliers de
distillation s’installèrent.
Le
premier « atelier de
distillation » testerin, qui fut aussi le premier dans la région,
apparaît vers 1810, aux Pigues, (entre les rues Gaston de Foix et Henri
Dheurle). Il est créé par Lesca fils
aîné qui avait déjà, en 1808, lors des adjudications effectuées par
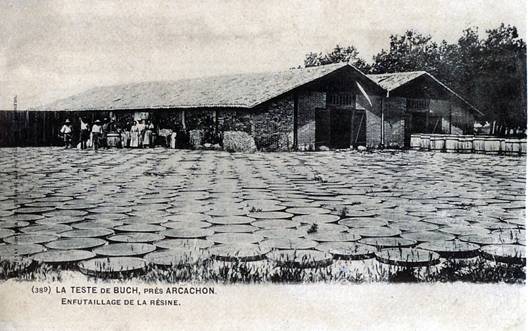
63-Colophane en plateau exposée,
au soleil pour la décolorer vers 1946. Contrairement
à la légende, il s’agit bien de l’ensoleillement des plateaux de
colophane, « l’enfutaillage » est à l’arrière- plan, à droite.[72]
Son
atelier ne fut officialisé qu’en 1817, le 22 Février, par
une ordonnance royale car au début il n’avait pas respecté le décret sur les
installations classées : le décret date en effet du 15 Octobre 1810, en
Novembre 1811 on y a ajouté les distilleries d’huile de térébenthine et tout cela
a été repris dans une ordonnance de 1815.
Suivront en 1821 la distillerie
d’huile de térébenthine de Bayle et Duha
(au Baou, à l’ouest de l’église), celle de Dejean en 1824 (à l’angle de la
route de Bordeaux et de la craste d’Arriet)[73],
de Dumora en 1825, (au Cousseau, près de la craste d’Arriet,) et de Castera en
1826 (au lieu-dit Péllèle où il est propriétaire entre les rues Lhermitte et
Pasteur).
Ces
ateliers « distillaient » donc la résine mais il n’y a pas de
description des installations
On sait que Castera possède un « alambic à essence de térébenthine », et que son entreprise et celles de Dejean et Dumora comportent toutes des « fours à goudron »
En 1826 ces ateliers traitaient chacun 1265 tonnes
de résine molle et de barras et exportaient vers la Bretagne leurs résine
cuite, essence de térébentine et brays gras.
Plus tard d’autres industriels recevront des
autorisations, reprenant souvent les ateliers existants : Conseil en 1863,
Lestout en 1864 au Haou (il brûlera en 1889), Moureau (reprenant en I865 celui
de Duha), la coopérative (en 1897 sur l’emplacement de l’atelier Dejean démoli
en 1882), Boisot (en 1921 près de la gare).
Outre les résines issues de la forêt usagère, ces
établissements traitaient aussi celles qui venaient des forêts privées . C’est
ainsi que les résines des forêts Lesca, sur la presqu’île, traversaient au
début du siècle, le bassin en bac à voile pour être ensuite déchargées sur le
port de La Teste eafin de rejoindre rejoindre la distillerie située chemin
latéral (rue André Lesca actuelle).

64- Photo
Gaby Bessières (collection « mémoire en Marensin »
2- A quoi
servaient les produits résineux au XIX° siècle ?
La réponse la plus complète que j’ai trouvée est
contenue dans une « Enquête du
Ministère de la guerre sur la reprise et le développement de la
vie industrielle dans la région landaise »[74].
Rédigée en 1917, elle donnait une liste très détaillée de l’utilisation des
produits résineux :
Essence de térébenthine
-vernis, couleurs, peintures, cires,
encaustiques, mastics, cuirs, graissage des étoffes -médecine
(hémorragies, rhumatismes, gouttes, coliques hépatiques, calculs, névralgie
biliaires, ténia)
-art vétérinaire
Colophanes et brais :
-frottement des crins d’archet des violons
-encollage des papiers
-savons
-encres d’imprimerie, noir de fumée
-lutte contre les gelées (en les faisant
brûler)
Huile de résine pyrogénée
-graisse végétale
-revêtement des tonneaux de bière pour
empêcher la fermentation
-injection des bois
-encres d’imprimerie et peintures
Résine jaune
-torches et chandelles
-collage des papiers
-soudure des métaux étamés
Pâte de térébenthine et
galipot
-vernis et cires à cacheter
-ocres lithographiques
-pharmacie (emplâtres)
-marine (peintures)
Brais noirs, brays gras et goudrons
-cordages
-coques et bois
-papiers et cartons « cirés »
Produits issus de mélange
-mastic de fontainier (colophane+graisse+brique pilée)
-mastic de greffage (colophane+poix+suif+ocre en
poudre)
-cire à cacheter les bouteilles (colophane+poix+cire)
-luter les récipients en bois (résine jaune+poix noire+suif)
La dernière distillerie à se maintenir fut

65-La
coopérative des résineux de La Teste en
1954 (AM LT)
Sa
cheminée fume à droite de l’avenue du
Général de Gaulle ; en arrière les tas de planches de la scierie Boisot.
Les deux
productions de
La première était utilisée comme solvant pour les
peintures, vernis, encaustiques et cirage et on l’employait aussi dans
l’industrie chimique
(terpines, huiles de pin, camphre…) ; quant aux
colophanes elles étaient destinées aux savonneries, aux colles de papeterie,
aux peintures, vernis, cires et poix.
4-
Production et revenus des intervenants.
a –les propriétaires, usagers ayant pins.
Pour
les périodes anciennes, il faut distinguer
l’ayant-pins qui travaille sa propre parcelle dont le genre de vie est
assez proche de celui du résinier, et le bourgeois, souvent négociant, qui
possède la parcelle et la fait travailler par un fermier. D’après les archives
cela semble le cas le plus fréquent et de toutes façons c’est cette catégorie
qui se manifeste la plupart du temps et mène les autres.
Au
XVII° la seule indication est contenue dans une supplique des habitants de Gujan qui se plaignent, le 3
mars 1639,[75]
du montant de la taille par rapport à ce que payent les testerins alors que
certains marchands de La teste (Caupos,Taffard) achètent les biens des gujanais
et monopolisent production et négoce. Ils disent, dans un autre document non daté, « on tient que le seul Caupos a 80 milliers de résine de
revenu » ce qui, en tenant compte des prix pratiqués à Dax en 1631 (
En
1751, on a vu que les propriétaires disaient, que la forêt produisait 1500
milliers de résine ce qui, au prix de
Quant aux goudrons et autres pègles
et brays gras, leur part est infime car les pins morts qui restent aux
« ayant-pins » ne peuvent être que des pins abattus par les tempêtes
(chablis) ou les pins incendiés. Dans tous les autres cas ils sont usagers.
C’est pourquoi, si la fabrication des poix, pègle et goudron de caillou,
utilisant les résidus du gemmage, était courante et vraisemblablement laissée,
quand il y en avait, au
résinier-fermier, (bien qu’aucun texte ne le confirme), celle des goudrons
coulants ne devait être active que dans des périodes limitées ; ce fut le
cas après l’incendie de 1716, ce dut être aussi le cas après l’ouragan de 1802
qui abattit 5039 pins[78]à
la suite duquel, Taffard de
Les difficultés quant aux estimations
concernant ces périodes, outre l’absence de comptes individuels, c’est
l’impossibilité de connaître, on l’a vu, la superficie de la forêt et le
nombre de propriétaires,
C’est
aussi le fait qu’on ne sait pas toujours
si les montants avancés sont des montants bruts ou des montants nets
part du résinier et gemayre déduites.
Nous possédons aussi la déclaration
de Fleury Aîné, faite en 1791[79]
pour le calcul de son imposition foncière. Il déclare environ
Mais,
la valeur de la monnaie ayant déjà chuté en ces premières années de la
Révolution, c’est la comparaison avec les salaires perçus pendant cette
période qui permet d’avoir une idée de
ce que cela représente : la même année, un ouvrier employé sur les semis
de Brémontier touche 24 sols (
Pour
le XIX° siècle un premier document
intéressant, mais à prendre cependant avec précautions car en matière fiscale
le contribuable a, de tous temps, tendance à minorer, est la protestation
contre les taxes foncières faite en 1814, le 14 mai, par le Conseil Municipal.
Elle détaille en effet les frais incombant aux propriétaires à
savoir :
1 cabane pour
le résinier (moyenne de 5 à 6 enfants)
………… 500
1 atelier pour
stocker la production…………………………….. .
100
1 four pour
cuire la résine……………………………………….. 120
1 puits
nécessaire au résinier et pour cuire la résine…………… 500
soit un total de 1220 francs
pour ces quatre objets qui peuvent durer 20 ans
Sur une production par an de 4 milliers de
résine, à 45 francs le millier, cela donne sur 20 ans un revenu de 2380
(3600-1220) soit 119 F/an.
A déduire
Le louage
d’une grande chaudière pour cuire la résine (
Le transport
depuis la forêt chez le propriétaire..…………………… 30
Le pesage pour
l’octroi (1 F/millier)………………………………….
4
soit 46 francs par millier (
Ce
qui, d’après ces conseillers, souvent propriétaires, laissait un revenu
net de
Si
l’on admet une stabilité du franc germinal au long du XIX° siècle, cela
donnerait 56,20 euros. Pour produire ces 4 milliers il aurait fallu, en
extrapolant d’après les chiffres
précédents, dans les 4000 pins soit un peu moins de
Un autre calcul est possible à
partir des chiffres de revenus (1681,33 francs) donnés en 1823 pour les
Nous savons d’autre part qu’en
1836/37 la parcelle de Binette, dans
En 1850, le revenu moyen
imposable à l’hectare est estimé à 6 francs (4,61 euros) en forêt usagère[84]
et la même année Bertrand Daisson, propriétaire à Labat du Porge (
Pourtant en 1860 où la barrique
vaut 66 francs, un autre document donne un revenu net de 52,50 francs par
hectare pour le propriétaire,(6,88 euros) ce qui, avec une densité de 150 pins
par hectare, correspond à 3000 pins gemmés.
En
1862, le « rapport des propriétaires
à
Le rapport estimant la superficie à
La guerre de sécession a en effet commencé aux Etats-Unis d’Amérique
tarissant du même coup les exportations de produits résineux que faisaient les états du sud, si bien que la barrique montera en 1864 jusqu’à 242 francs pour retomber ensuite très vite (45 francs en 1869), tandis que le quintal de produits sec se négociera alors entre 6 et 7 francs.
Ces
sondages montrent que la résine rapporte
mais que les revenus fluctuent selon les
années car les cours sont très variables. D’autre part cela dépend aussi du
rendement obtenu qui ne doit pas être uniforme : le nombre de pins gemmés,
la façon plus ou moins intensive de le faire doit varier selon les parcelles.
Enfin, il faut rappeler que la monnaie est, jusqu’au Franc germinal, souvent
dévaluée.[85]
Un
autre aspect à envisager c’est la valeur du capital forestier. L’examen d’actes
notariés portant sur l’année 1846 donne les résultats suivants :

66-
Si
la valeur du terrain en forêt usagère
est faible, c’est que les pins n’appartiennent pas au
« propriétaire » qui ne peut
en retirer que les revenus du gemmage.
Par contre quand il s’agit de parcelles situées dans
b- Les
« gemmeurs ».
-Leurs revenus
Que
sait-on par contre du revenu des
arousineys ? Peu de choses pour les périodes anciennes où le
produit sortant de la forêt était la rousine cuite dans une chaudière.
Les 46 gemmeurs testerins représentaient, en
1746, 12,77 % des chefs de famille présents pour ratifier la nouvelle
transaction. Même s’ils n’étaient plus que 35 dans la période 1780/89, ils représentaient encore 16,9 % des
métiers masculins et leur nombre monta à 103 en 1796, dont 8 résinières.
Ils
étaient pour la plupart liés aux propriétaires, souvent négociants,
par des contrats de fermage. Ainsi en 1755 Jean Baptiste Peyjehan donne à ferme
à Jean Taffard dit Lahillone, la pièce de
Ces
contrats prévoient parfois l’obligation
de se fournir en « bleds »
chez ce même propriétaire. C’est le cas en 1777[87]
de Bernard Dessans devant, pour les pièces des Péchious et des Taulette, à
Nicolas Taffard, Conseiller en
Autre
contrat, celui qui lie le même Nicolas Taffard à Jean Senturenne pour les
pièces de Chicoy Bougès, Broustics et Monscitrans[89],
affermées pendant 5 ans pour la somme de
Plus
tard, en 1844[90],
Joseph Desgons afferme, pour 9 ans, ses pièces des Deux Hourns et Braouet avec « cabanes, barques, fours,
chaudières puits et autres » aux conditions suivantes :
-« ils cultiveront et
soigneront en bons ménagers et père de famille »
-ils
livreront au I° janvier,
-deux
paires de bécasses par an à la Saint Martin.
Il
est noté que le four des Deux Hourns fait partie du bail, à charge pour les preneurs de le tenir en bon état de
réparation locative et de fournir en Juillet
8 stères de charbon de bois en provenant soit en nature soit en argent au choix de Desgons.
Comme
un four traditionnel n’aurait pu fournir de telles quantités de charbon de
bois, il s’agit donc toujours du four de type suédois construit à Sanglarine en
1663 !
En
outre il se réserve le droit de faire payer tout individu qui puisera de l’eau
au puits des Deux Hourns.
Le
fait de donner des paires de bécasses se retrouve souvent, les bourgeois se
comportant ainsi comme l’ancien Captal…et, quand les pièces affermées se
trouvent en bordure du lac, ce sont souvent des poissons qui sont ajoutés :
ainsi la même année, JM. Ostinde Pontac
et J. Dejean exigent en plus des
Comme
on le voit ces contrats de fermage prévoient souvent, en plus du loyer en
nature (milliers de résine) des compléments en argent. Le résinier disposait en
général des autres produits (thérébentine de soleil ou poix) qu’il pouvait donc
vendre (le plus souvent au même négociant-propriétaire) et des produits de la
chasse ,bécasses (24 sols la paire en 1761) et autres gibiers. Mais, les prix
étant fixés par le négociant, ils se trouvent de plus en plus sous sa coupe et
leur rythme de travail est conditionné par les quantités qu’ils doivent
livrer : souvent aidé de sa femme et de ses enfants, un résinier peut, d’après
le naturaliste Jean Thore (1862-1825), « sortir » il
Nous
ne savons pas grand chose du mode de vie de ces résiniers mais quelques
témoignages permettent cependant de s’en faire une idée
-Portraits
et mode de vie.
Au début du XVIII° siècle, Claude Masse décrit ainsi ceux de la
Montagne de Lacanau :
« Les résiniers sont des hommes, à faire
peur à voir tant par leurs habits que par leur langage rustique et sauvage.
Parlant d'un mauvais gascon ils sont ordinairement jambes et pieds nus et ont
sur la tête une toque ou baret n'ayant ni cravate ni collet. Ils se couvrent le
corps d'une dalmatique brune avec un capuchon et au dessus un juste au corps
et une culotte le plus souvent de peau. Ces pauvres malheureux habitent les
bois de pins dans de petites maisons ou cabanes bâties de planches ou de
colombages avec de la terre, ne croissant point de pierre dans toute la côte du
Médoc. Les plus aisés ont quelques cochons, chèvres, vaches, bourriques,
petits chevaux et quelques mouches à miel qui est le grand revenu du pays. Mais
la plupart manquent de fourrage pour la nourriture de leurs bestiaux, ne croissant
pas d'herbe dans les pins. Ils ont peu de volailles parce qu'elle se perd dans
les bois ou que les renards, fouine ou oiseaux de rapine les mangent. Les œufs
de ces volailles sont d'un mauvais goût et sentent la résine. En un mot ces
pauvres malheureux sont dignes de compassion de même que leurs familles. Il n'est point
étonnant que leurs femmes et enfants se cachent quand ils voient des hommes
avec leurs chapeaux ne voyant du monde que les dimanches quand ils vont au
service divin; souvent leurs paroisses sont éloignées d'une lieue ou deux; il
n'y a que le curé qui est en chapeau.
Les résiniers se nourrissent
aussi mal qu'ils sont habillés, ne mangeant que de très mauvais pain de seigle
et quelque peu de bled d'Espagne. Ils font la soupe avec de l'eau et du sel et
pour graisse de l'huile d'olive puante qu'ils trouvent la meilleure et quand
ils ont de l'ail et (ou) de l'oignon, ils s'estiment très heureux car ils
mangent peu de viandes. Quand ils viennent à Bordeaux ils achètent un pain blanc qu'ils mangent avec leur pain noir au lieu de fromage ou de
viande et quand ils aperçoivent quelqu'un qui mange le pain blanc seul sans le
mestre avec le pain noir, ils l'appellent : « gourmandasse qui
maindge le choigne sans pain», c'est à dire gourmand qui mange le pain blanc
sans le mettre avec le pain noir qui est le plus mauvais. Il y a de ces
peuples qui n'ont jamais mangé de beurre ni de fromage, ne le sachant pas
faire, surtout celui de vache ; ils en font quelque peu avec du lait de chèvre
ou de brebis qui est très mauvais. Ils mangent généralement tout à l'huile
puante comme il est dit cy devant et ils disent de l'autre huile «Ah quel holi
ne vaut rien en sant pas» qui veut dire que l'huile ne vaut rien parce qu'elle
ne sent pas (mauvais), ce qui est très mauvais ragoût pour les pauvres étrangers »
Bien qu’étranger au pays, ayant tendance, comme souvent, à considérer
les indigènes comme des sauvages, Claude Masse n’était certainement pas loin de
la réalité car deux siècles plus tard, à la fin du XIX° siècle, voici le père
du poète Gilbert Sore[92] :
Très jeune Landais de Moustey
La cabane sent la résine ;
Mon père s'en vint à La
Teste Six jours de semaine
durant
Loué par un « arrousiney
» Il vit de pain, d'eau,
de sardine
« Sec coum un paou, la came
leste. Dans un silence murmurant.
Alors, le pitey sur
l'épaule, Il est
vaillant, il ne complique
Des matines à
l'angélus, Ni son
esprit, ni sa raison,
Son hapchot chante, siffle,
miaule Fait couler soixante barriques
Pour couper les pins du
Natus. Dans le cours de chaque
saison.
Mais le dimanche
tout l'attire
Au bourg: il
fréquente le bal,
Il sait danser,
plaisanter, rire.
Ah! ce dimanche
quel, régal !
Il voudrait
prolonger la fête.
Voici un autre témoignage celui d’Alexis Baillon qui résinait à la fin
du XIX° siècle[93] :
« Mon père…pica les
pins d’abord à La bat du loup ensuite aux Tioules. Il avait une maison à La
Teste au quartier du Dadé…mais nous n’y venions que tous les quinze jours,
vivant le reste du temps dans notre cabane de
Certaines nuits, pour
améliorer le pauvre ordinaire du foyer, mon père partait de la cabane pour
aller à la côte pécher à pied à la « haille », c'est-à-dire au
flambeau. Portant sur son dos lou haillas (grill muni d’une longue tige sur lequel
brûlait un feu de tède pour attirer le poisson, cet instrument était fixé au
pêcheur par des courroies), lou salé (
foëne à six ou sept dents , un sac rempli
de tède ( partie la plus résineuse du pin), un autre sac pour mettre le poisson, une bouteille d’huile qui lui
servait à calmer la surface de l’eau quand la mer était agitée, enfin un petit
casse croûte. Après avoir effectué dans la nuit six à sept kilomètres sur les
chemins tortueux de la forêt, il arrivait à Dulet et n’avait plus qu’à
escalader la dune pour être sur la plage, car c’était au pied de la grande dune
du Pilat qu’on prenait les plus belles soles. Il marchait toujours pieds nus et
la plante de ses pieds n’était plus qu’une corne dure….
Ma mère travaillait aux pins
comme mon père.
Tous les quinze jours, nous
faisions les dix kilomètres qui séparaient la cabane de notre maison de Dadé, mon
père un fagot de bois sur le dos et ma mère portant un sac de pignes et de
galips…. Le soir venu, tout le monde regagnait la cabane dans la nuit chargé
des provisions pour la quinzaine. Le foin pour la vache, le grain pour les
poules et le vin étaient apportés par mes grands parents paternels…qui avaient
un mulet…
Notre pauvreté obligeait ma
mère à supprimer toute gourmandise de nos repas sauf …à Carnaval (un grand plat
de crêpes) et à
Des gens pauvres donc mais pas des « sauvages » bien que ceux
du dehors aient continué de les voir d’un œil citadin, ainsi, en 1839, le baron
De Mortemart[94]
dit que le résinier « est presque
aussi sauvage que le berger landais mais sa maison de bois, au milieu des
forêts de pins, est entourée d’une vigne qui vient festonner sa corniche ;
son petit jardin a quelques pêchers, un puits d’eau potable sert à désaltérer
sa famille ;il a parfois une vache qui fait la richesse de sa demeure et
toujours des porcs sauvages qui vont, le jour, chercher leur vie dans la forêt
et rentrent avec lui, le soir, dans l’habitation commune …
Cet homme est ordinairement
agile et adroit, sans ces deux qualités il ne pourrait remplir son office (utiliser le pitey).»
C’est aussi l’opinion, la même année du Comte de Bonneval qui
écrit « il existe encore une
autre espèce de sauvage qui habite les forêts de pins (mais) l’intelligence des résiniers est plus
développée que celle des bergers » ![95]
Le sommet sera atteint, en 1906, par François Daleau[96]
qui, visitant la cabane de Courpeyres y voit « un de ces hommes, nu-pieds, assis près de l’âtre sur un escabeau
rudimentaire (qui) prit un tison avec
ses orteils, le porta à sa main, le saisit et en alluma sa pipe » et
le voyageur note « préhension
simienne » (semblable à celle des singes !) ajoutant « ces primitifs m’ont fait entrevoir
ce que devaient être, il y a quelque mille ans, les lacustres de l’âge de la
pierre polie » !
Il est certain que le physique des
résiniers se ressentait de la dureté de leur travail, c’est ce
qu’avaient remarqué les médecins locaux, Jean Hameau qui, en 1807[97],
les décrit « petits, maigres, d’un
teint basané » contrairement au « beau
coloris et aux formes agréables que l’on voit aux marins » et Auguste
Lalesque, en 1835[98],
ce sont des êtres « pâles, maigres,
terreux, presque imberbes, petits et débilités, vieillis prématurément »
En ce qui concerne leurs cabanes, outre les dessins toujours précieux
de Léo Drouyn, comme celui-ci de 1851, il y a, par l’Abbé Mouls, en 1860,
l’évocation de la cabane « proche
de Notre Dame d’Arcachon » telle qu’elle était au début du siècle.
« chaumière, mi bois mi moellons
ferrugineux du pays, à peine crépis, couverte de tuiles…une porte basse au sud,
deux pièces séparées par une mauvaise cloison de bois. » L’une, la
cuisine, comporte une cheminée sur le mur ouest, sans pieds droits elle est
soutenue par un manteau de bois. Les chenets sont « deux pierres des landes » c'est-à-dire des garluches.
Comme mobilier il n’y a que des étagères
soutenant la vaisselle en bois, un pétrin et un tabouret constitué d’une
planche sur 3 piquets. » ; sur le mur nord sont suspendus les
outils : « pitey, hachettes,
pelles »
----------------  ---------------------
---------------------
67-Cabane en forêt- Léo Drouyn
1851 (CLEM)
Quant à la chambre, il y a
« aux deux encoignures deux lits en forme de coffre sans rideaux avec une
paillasse, un drap de serge grise et une couverture de coton. ». Il
ajoute que la charpente est à nu et qu’il n’y a pas d’entablement à la jonction
avec les murs, ce qui donne « lumière
et circulation d’air ».
Quarante ans plus tard, en 1904, Durègne de Launaguet, à son tour
décrit une cabane et ne constate guère d’évolution. J’ai illustré son texte par
une gravure de Kauffmann publiée en 1890 dans
son « Tour du monde »
« L’habitation se compose en général de deux pièces, l’une servant
de dortoir, l’autre de salle commune où l’âtre rustique est alimenté à
profusion. C’est dans cette pièce tapissée de naïves images ou de journaux
illustrés que sont suspendus les outils du résinier ainsi que sa vaisselle
primitive où figurent des cuillers, des plats, des récipients fabriqués par
l’habitant lui-même en bois de chêne ou d’arbousier.
A côté un abri rustique pour
la vache ou l’âne ; le poulailler est installé dans un arbre à cause du
dangereux voisinage des renards, les lapins gambadent tout autour en liberté,
un petit jardin potager, quelques arbres fruitiers, des ruches, l’ombrage de
quelque gros chênes complètent ce tableau. »
Visitant la cabane des Ledouneys, il signale une chambre de plus avec 2
ou 3 lits faisant corps avec la charpente et le tchitchoun (le lard) pendu dans
la salle commune.
Le mobilier et les ustensiles étaient rudimentaires, c’est ainsi que
François Daleau ne remarque dans la cabane des Courpeyres que des objets
fabriqués par les résiniers eux-mêmes « la
thieure, cornet d’appel, tube cylindrique conique en bois de pin creusé
grossièrement ; le saley de boy, écuelle soupière en bois de chêne et les
peychottes, cuillères en arbousier à manche plat
Rien n’a beaucoup changé au fil des temps, ce qui explique en grande
partie l’évolution de ce milieu
autrefois testerin qui a, on va le voir, a compté de plus en plus d’immigrés.
5-
La fin du gemmage.
a- L’évolution
de la production
Au
XX° siècle , les statistiques publiées ne concernent que la période 1946/1977
date de la fermeture de
Cette
fermeture a été le résultat de l’évolution du commerce international et de la
concurrence de certains producteurs étrangers tels que la Chine, le Portugal et
l’Amérique du Sud : la France important alors des produits résineux, par
exemple mexicains, qui revenaient moins chers que les produits locaux !

68-Graphique de l’évolution de la production de
gemme de 1946 à 1977 (R.Aufan)
De
plus les produits qui sortaient de l’usine de La Teste (colophanes et
térébenthines) étaient de plus en plus concurrencés par les dérivés pétroliers,
ainsi le white spirit de moins bonne qualité mais bien moins cher que la
térébentine !
b- L’évolution
démographique
La
fin du gemmage est donc le résultat
d’une situation économique qui laminaient les revenus des
« ayant-pins » et ne laissaient que peu de revenus aux gemmeurs
souvent étrangers.
Seules
58% des 140 parcelles étaient gemmées en 1970, elles n’étaient plus que 34
% en 1977.
D’après
les chiffres fournis par le SRAF, il y avait 23 propriétaires –
exploitants contre 120 résiniers salariés en 1960, nombres réduits à 6 et
8O en 1970 puis à 2 et 31 en 1977.
Une
autre source, celle du syndicat des résiniers[99],
donne pour la même période 77 résiniers
(mais elle englobe, en plus des chefs de famille, tous les membres qui
travaillent, ce qui explique la différence). Elle ne relève toujours que 2
propriétaires exploitant et seulement 12 français soit 15,5 % de
l’effectif. Quant à l’âge moyen des
résiniers encore en activité il était de
60 ans pour les français contre 35 à 40 ans pour les étrangers.
Cette
situation traduisait le peu d’attractivité d’une profession dont les revenus
permettaient à peine de vivre.
c- L’évolution
économique
Entre
1969 et 1978, d’après l’étude menée en 1979 par la SEPANSO et l’UER L’homme et
son environnement, les salaires bruts par hectolitre du gemmeur s’élevaient en
francs à
1969-70 52 1973-74 77,16
1970-7I 54,60
1975-76 97
1971-72 60
1976-77 115
1972-73 65,80 1977-78 120
Ces
chiffres correspondaient au salaire brut augmenté des congés payés et de
l’indemnité correspondant au I° Mai et diminués des cotisations sociales. Leurs
fluctuations dépendaient du prix de vente de la gemme calculé en fin de
campagne, le gemmeur recevant en cours d’année des acomptes.
Une
moyenne de 6000 pins gemmés et une production de 120 hectolitres donnait au
résinier un revenu net de 2200 francs par mois.
Quant
aux « ayant-pins », l’effondrement des cours fait que pendant
la dernière campagne 1976-77 ils ne touchèrent que 11,56 francs par hectolitre.
A
titre d’exemple voici les revenus d’une parcelle de forêt reconstitués d’après
des archives privées .Les sommes indiquées sont en francs et le bénéfice devait
être partagé, par le gérant, en… 17 parts inégales. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer l’augmentation
importante de la production lors de la dernière campagne
-------69---- --------
--------
En
1976, la décision du gouvernement de limiter autoritairement la production afin de décourager les exploitants de
continuer dans cette voie provoqua une crise qui entraîna en 1977 la fermeture
de
La
situation continua à se dégrader , c’est ainsi qu’en 1982, d’après un reportage
du journal Sud-ouest, un des derniers gemmeurs de la forêt qui produisait
Quant
au propriétaire le même article disait qu’il lui revenait 20 centimes par
litre, soit, sur la même base 3600 francs.
Cette
gemme était traitée par la coopérative de
Biscarrosse qui l’achetait 2,64 francs le litre, le coût de production
revenait à 3,88 francs et le Fonds d’Organisation et de Régularisation des
Marchés Agricoles garantissant un prix de 5,03 francs, comblait la
différence entre le prix « français » et celui, plus bas, du
marché mondial.
Après
1977 et pendant quelques années encore,
la gemme testerine fut donc transportée à Biscarrosse puis le gemmage s’arrêta
définitivement
C’est
cet arrêt du gemmage qui donna le coup de grâce à l’ancien statut usager de la
forêt.
En
effet ce systèmes était économiquement basé sur l’équation suivante : aux
uns, les « ayant-pins », le sol, les cabanes et la gemme, aux
autres, les usagers non ayant-pins, le bois.
La
disparition de la gemme faisait que ce statut devenait irrationnel,
l’ayant-pins qui n’avait plus de revenu continuait à payer les cotisations de
Mais pour cela il fallait cantonner, c’est à dire, on le verra, supprimer le statut usager ; or la procédure judiciaire qui fut alors lancée n’est, 30 ans plus tard, toujours pas terminée… !
Cette décision hâta
d’ailleurs la fin du gemmage. En effet comme il fallait prouver que la forêt ne
rapportait plus rien, la plupart des résiniers furent remerciés comme en
témoignent de nombreuses lettres quasi identiques reçues par les résiniers
entre décembre 1977 et Janvier 1978.


 ------------
------------